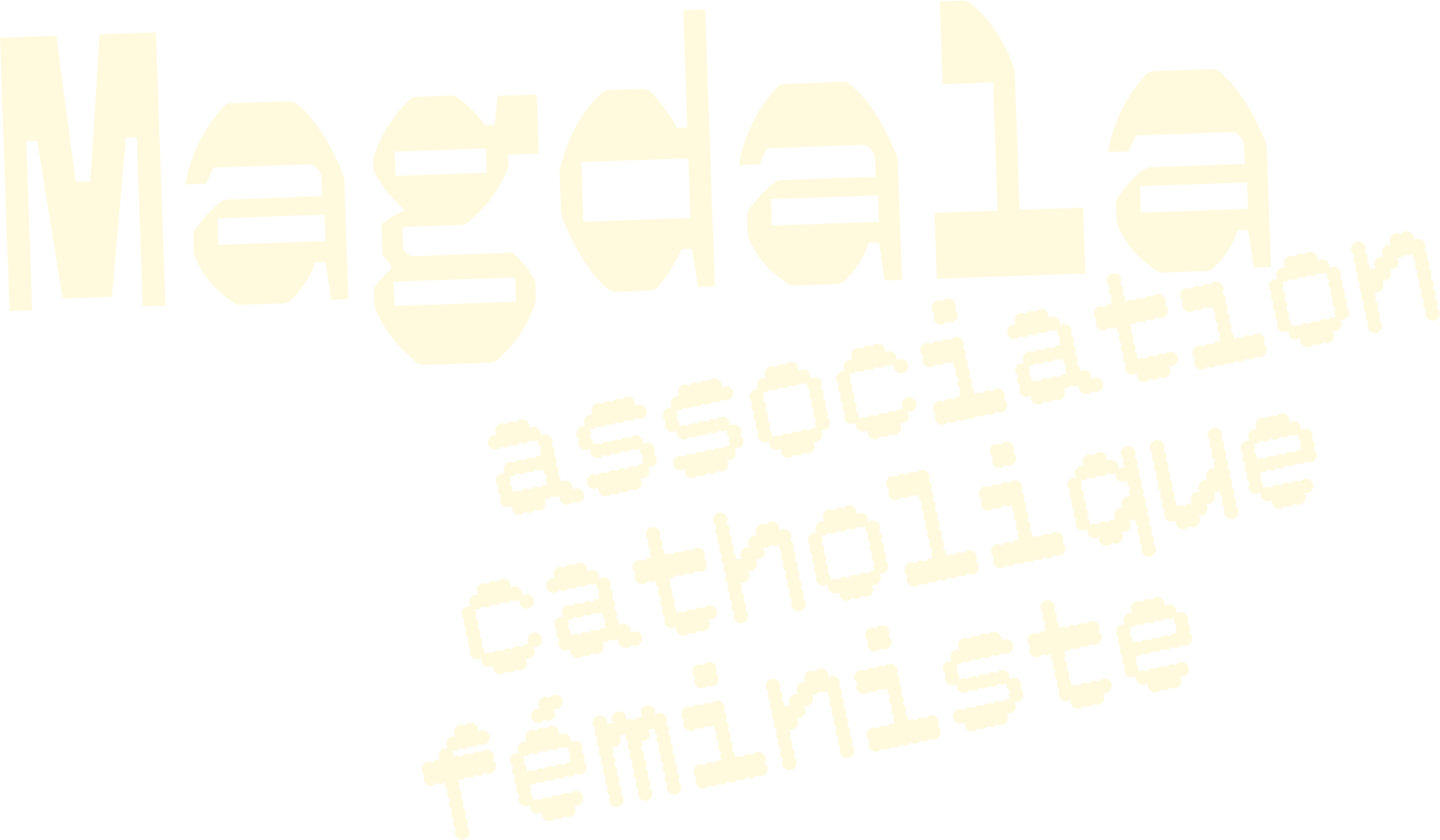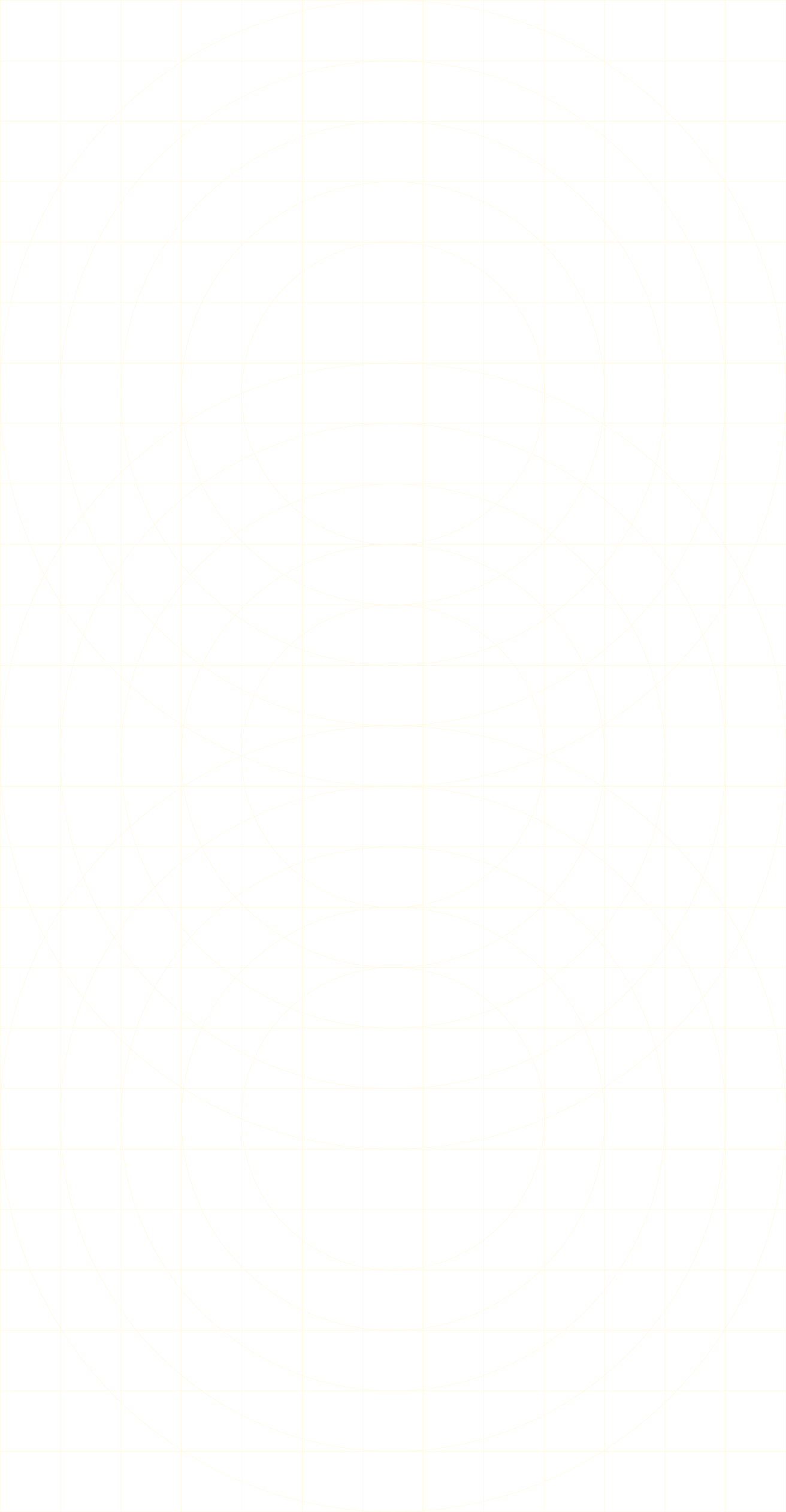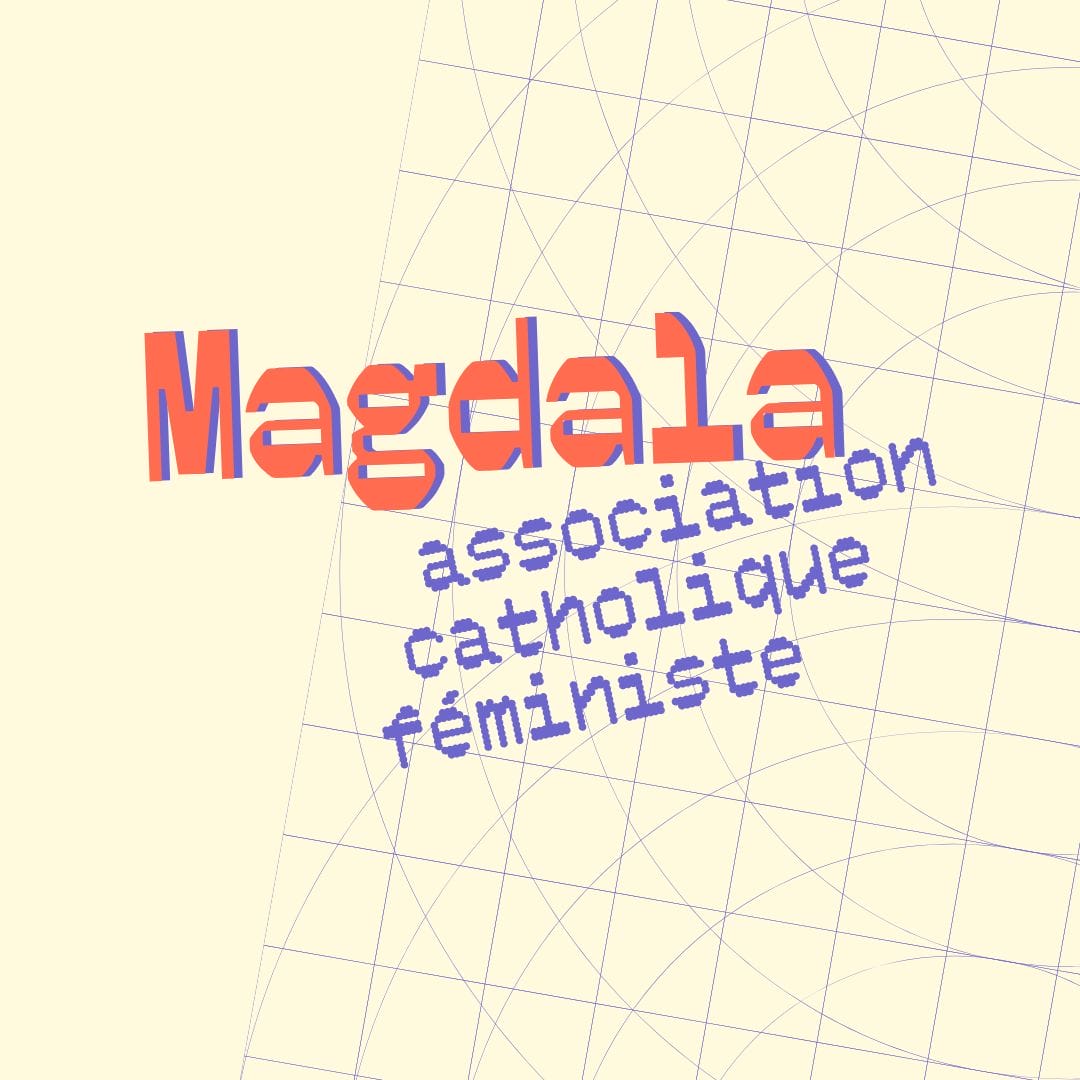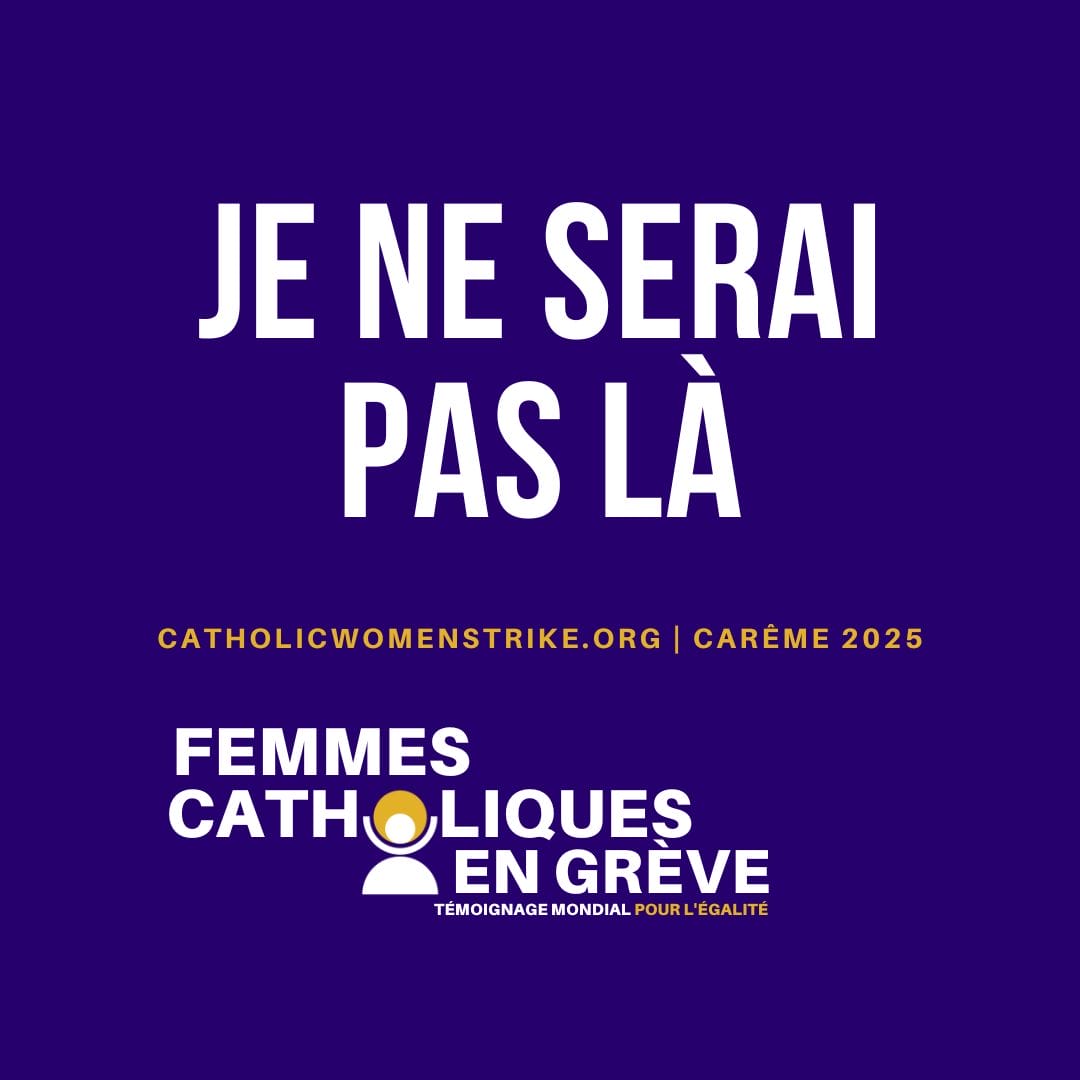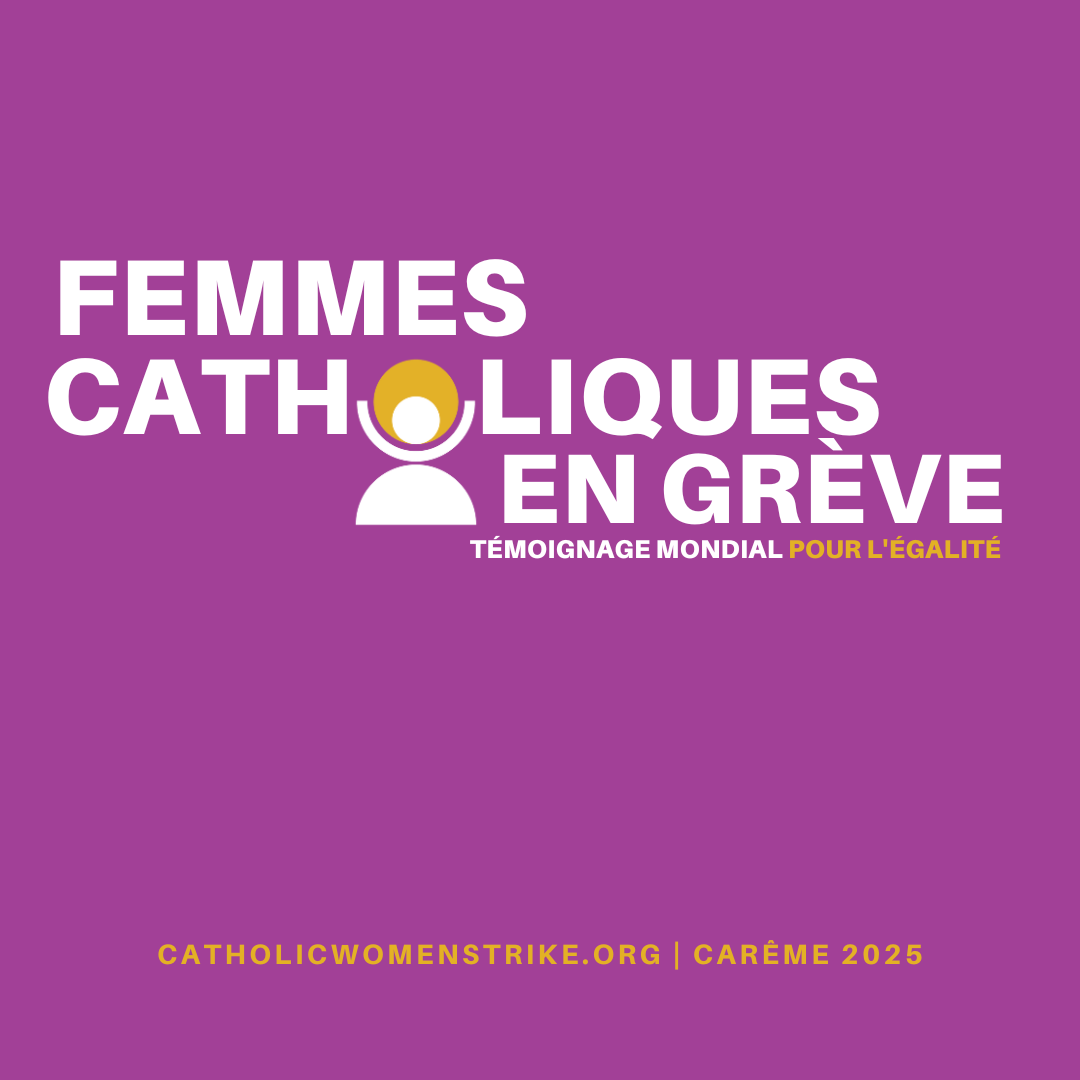Publié le 31 octobre 2024
L’homélie, pièce maîtresse de tout célébration, confiée à une femme ? Non, elles peuvent prier, chanter, fleurir l’église, faire le ménage, mais commenter des Écritures, c’est une affaire sérieuse ! Une affaire d’hommes. Cet été, nous sommes plusieurs à avoir bousculé cet interdit catholique. Nous partageons ici notre expérience pour qu’elle se multiplie ! Comme il est bon et libérateur d’oser un commentaire d’évangile !
Nous sommes deux femmes engagées au Comité de la Jupe :
Clémence, j’ai 24 ans et lors d’un festival de chrétien·nes qui s’engagent pour la justice écologique et sociale, on m’a proposé de faire un commentaire en duo de l’évangile pendant la messe.
Frédérique : j’ai 62 ans. Je milite dans plusieurs mouvements écologistes et féministes. Cet été au « Village de l’eau » organisé en Poitou par les Soulèvements de la Terre, nous étions 10 000 à protester contre l’accaparement de l’eau par les mégabassines. Or sur ces lieux de lutte, plusieurs personnes désiraient une part spirituelle. Venu·es de Lutte et Contemplation, de Laudato sì, et du Comité de la jupe : nous avons initié un groupe de prière en marge de cette semaine de l’eau.
Premières réactions :
Clémence : Au moment de cette proposition, ma première réaction a été d’être en joie. Étant déjà engagée sur le sujet du féminisme, j’ai déjà eu à faire face au sentiment d’illégitimité et, même si celui-ci est revenu lors de cette proposition, j’ai rapidement décidé que je voulais passer outre pour accepter cette mission et vivre une réelle aventure. J’ai donc fait le commentaire de l’évangile de Marc (6,7-13) avec une amie.
Frédérique : Pour la célébration finale, j’ai désiré faire l’homélie, en proposant de faire relire mon texte au groupe en amont. Réponse : « Non, on te fait confiance ! D’habitude, on ne relit pas le texte du curé ! » J’en jubile encore. Car mon expérience quotidienne de femme, c’est d’être ignorée, invisibilisée, envisagée avec méfiance.
Confection du texte :
Clémence : Après plusieurs temps de prières personnelles sur les textes de la liturgie de la messe, j’ai ensuite noté la relecture de celles-ci et faisant particulièrement attention aux mots ou phrases qui avaient du goût, c’est-à-dire ceux qui m’ont fait méditer afin de comprendre un peu plus la beauté de Dieu. Ensuite, j’ai eu une immense chance de faire ce travail en duo avec une amie et, le moment que j’ai le plus apprécié est de loin les discussions et les échanges que nous avons eu toutes les deux sur ces textes. Cette opportunité nous a permis d’échanger sur les fruits de nos prières mais aussi de parler plus profondément de notre foi.
Frédérique : J’ai l’expérience de l’écriture à plusieurs titres ; je sais que le temps est notre allié. On plante une graine, un sujet. Puis notre inconscient et l’Esprit aident. Tout au long de la semaine, j’ai ruminé mon homélie, au fil des rencontres, des conférences, des actions vécues en commun au « Village de l’eau ». Le texte s’est écrit tout seul.
Dans le moment :
Clémence : La messe s’est déroulée en extérieur. Le stress est monté lors de l’écoute de l’évangile mais, le fait de prendre la parole à deux était plus agréable. Lors de notre lecture, nous avons féminisé certains mots comme prêtresse, prophétesse et reine et nous nous sommes permis de faire quelques pointes d’humour. Nous avons aussi adapté notre texte en fonction des personnes qui étaient devant nous : se questionner de la manière dont Jésus nous envoie en mission, à l’image des disciples.
Frédérique : La beauté du cadre et des gens a produit un moment magique. Les paroissien·nes de Melle ont trouvé un arboretum pour une célébration en plein air qui couronnait cette semaine de défense de l’eau. Prière apache à la Terre, chants de Taizé, « Notre Mère » au féminin : nous étions une quarantaine, porté·es par un esprit d’ouverture aux autres vivants. J’ai pris très naturellement la parole, avec l’impression que je ne parlais pas seule. D’après le texte du jour (Marc 6, 30-36), le cœur du propos était : où trouver l’espérance dans une situation désespérante ?
Afters :
Clémence : Les réactions qui me sont parvenues ont été positives, en me disant qu’il était bon que des femmes prennent la parole. J’ai conscience que je n’ai pas fait d’études de théologie et que je ne suis pas une experte de la bible mais nous l’avons fait avec le cœur et je dirais même, avec Dieu.
Frédérique : On a eu plein de retours positifs sur notre célébration et même un article dans La Vie1. Bien sûr je me pose la question de la légitimité. Je ne suis pas théologienne. Il ne faut pas se priver de vérifier ses sources lors de la préparation ! Mais si on parle dans un esprit de sororité, vraiment
horizontal, rien n’empêche d’en discuter après la célébration. L’homélie n’est pas un point final, c’est une proposition qu’on partage.
Légitimité à faire une « Homélie » ?
Selon l’instruction Redemptionis Sacramentum émise le 25 mars 2004 par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, l’Église y rappelle les règles à suivre pour la messe : « Dans la célébration de la sainte Liturgie, la lecture de l’Évangile, qui « constitue le sommet de la liturgie de la Parole », est réservée, selon la tradition de l’Église, au ministre ordonné. Il n’est donc pas licite qu’un laïc, y compris un religieux, proclame l’Évangile durant la célébration de la sainte Messe, ni dans tous les autres cas, où les normes n’accordent pas explicitement une telle autorisation. »2. Donc seuls les prêtres peuvent faire des homélies et commenter les Écritures. Est-ce pour cela que ce mot a aussi le sens dans le Robert de « longue et ennuyeuse leçon de morale » ?… Si l’Église doit avoir une tradition vivante comme le disait Bernard Sesboüé, réformons aussi les prises de parole ! Revenons aux origines. À l’origine, le mot désignait aussi bien une réunion, ou une association de personnes qu’une conversation familière, informelle. Non pas des actes solennels, confisqués par les clercs.
Conclusion
Clémence : Cette expérience, qui a été pour moi un réel cadeau, me pousse à écrire ce texte pour crier haut et fort qu’il est possible pour toute chrétienne de s’exprimer publiquement pour prêcher la bonne nouvelle. Et pour tout dire, de mon point de vue mais aussi de celui de nos auditeuri·ces, je pense que cela permet de montrer d’autres formes de célébration du Christ et que cette joie de l’exprimer n’est pas réservée aux prêtres.
Frédérique : Comme pour Clémence, ça a été pour moi une expérience de joie que de dépasser mes limites, de partager un privilège d’habitude réservé aux prêtres. La joie du partage, de l’aide apportée à autrui, de l’intelligence collective ; mais aussi de l’émancipation, de la prise de confiance et de l’« empuissantement », pour nous qui sommes encore aujourd’hui largement encouragées au silence. Et avoir subi tant de sermons, ça donne envie de faire court ! Comme le disait en son temps Denis Sonet du CLER : pour les adultes la messe, ça dure une heure. Pour les enfants ? deux heures… Mais
pour le curé ? 20 minutes ! Dont acte !
1 La Vie, 2024, https://www.lavie.fr/actualite/ecologie/une-celebration-religieuse-organisee-lors-du-rassemblement-contre-les-megabassines-95572.php photos Adrien Auzanneau, Hans Lucas, Une célébration religieuse organisée lors du rassemblement contre les mégabassines
2 Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Redemptionis Sacramentum, §63, 2004